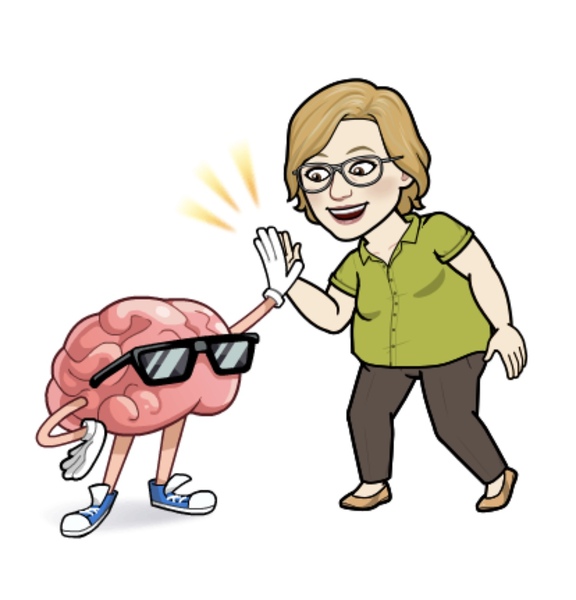Plaidoyer pour une neurothérapie incarnée face à l’impasse cérébrale du TDAH
Depuis trente ans, le cerveau est devenu l’objet roi :
le Graal des pédagogues, le fétiche des cliniciens, le repère des praticiens en quête de certitude.
On le traque à coups de Z-scores, on le redresse à coups de protocoles.
Mais dans cette quête de maîtrise, on a oublié l’essentiel :
le vivant ne se résume pas à une carte cérébrale.
Le TDAH, comme bien d’autres troubles, a été réduit à un dysfonctionnement neuronal.
Mais il n’est pas qu’un déficit attentionnel :
il est souvent une cascade de dérégulations – toniques, respiratoires, posturales, relationnelles.
Le réduire à un schéma cérébral,
c’est passer à côté des enfants qui respirent mal, dorment mal, se tiennent mal —
non pas parce qu’ils sont déficitaires,
mais parce qu’on ne leur a jamais appris à habiter leur corps.
Et derrière les écrans, des thérapeutes, trop souvent,
il y a une peur de ne pas savoir. Alors, on compense avec des machines.
On veut corriger ce qu’on ne comprend pas encore.
Mais à trop vouloir contrôler le cerveau,
on finit par oublier d’écouter le vivant.
Ce texte n’est pas une attaque. C’est une secousse.
Une invitation à descendre dans le corps, à remettre les pieds dans le sol.
À redonner au neurofeedback son sens premier : non pas corriger, mais révéler.
Car bien utilisé, il peut devenir un miroir du vivant,
un allié immense dans le développement de la conscience de soi,
un soutien à l’observation, à l’autorégulation.
Le neurofeedback n’est pas une fin.
C’est un chemin — à condition d’en changer la boussole.
Bienvenue dans un autre paradigme.
Introduction :
Quand le TDAH révèle un malentendu plus large
Le TDAH est devenu, en quelques décennies, le porte-étendard d’une crise silencieuse : celle de notre rapport au cerveau. Derrière les diagnostics massifs, les évaluations standardisées et les solutions dites « scientifiquement validées », se cache un malentendu plus profond : l’idée, largement répandue, que tout vient du cerveau, que tout se soigne dans le cerveau, que tout se mesure par le cerveau.
Et c’est précisément ce malentendu que nous, neurothérapeutes intégratifs, avons décidé de déconstruire. Non pour nous opposer aux neurosciences, mais pour en libérer la puissance, en la reconnectant à ce qu’elles oublient trop souvent : le corps, le souffle, le tonus, la relation.
1. Le neurofeedback a conquis ses galons… mais dans un paradigme déjà réducteur
Au tournant des années 2000, le neurofeedback s’est imposé outre-Atlantique comme une alternative prometteuse aux traitements médicamenteux, notamment dans la prise en charge du TDAH. Porté par l’essor des bases de données EEG normatives et des outils d’analyse quantitative, il a offert aux cliniciens un outil de régulation non invasif, technologiquement séduisant.

Mais en s’adossant à une lecture strictement cérébrale des troubles, le neurofeedback s’est aussi piégé lui-même. Il a renforcé l’idée qu’il existe une norme cérébrale, que tout écart est pathologique, et que l’intervention consiste à corriger l’écart. Le cerveau est devenu un centre de commande isolé, à réaligner, à lisser, à discipliner.
2. Une lecture désincarnée du vivant
Cette posture techniciste a conduit à une forme de fétichisation du signal EEG. On a oublié que ce signal est traversé par le corps : par la respiration, la posture, les tensions musculaires, le vécu tonico-émotionnel du sujet. On a appelé « artefact » ce qui était en réalité une empreinte vivante.

Nettoyer, corriger, standardiser… autant d’actions qui ont pu, insidieusement, gommer ce que l’enfant ou l’adulte apportait de plus précieux : son mode d’adaptation, sa singularité expressive, son effort pour tenir debout dans un monde qui l’écrase.
3. Le fantasme d’objectivité et le refuge du thérapeute
Derrière cette lecture froide se cache souvent une quête implicite : celle du thérapeute qui cherche, dans la technologie, à compenser l’incertitude de la relation. Ce que la psychologie n’a pas toujours su offrir — une rigueur, une clarté, une légitimité scientifique —, les neurosciences l’ont promis. Et le thérapeute s’est parfois réfugié dans le protocole comme dans une armure.
Mais un protocole ne pense pas. Il n’écoute pas. Il ne sent pas. Et c’est ainsi qu’en voulant gagner en précision, on a parfois perdu en présence.
4. La spécificité de la neurothérapie intégrative : un art d’écouter l’empreinte
Affirmer notre différence, ce n’est pas rejeter ce qui a été fait. C’est affirmer que nous refusons de réduire l’humain à une carte cérébrale. En tant que professionnels de l’accompagnement, nous choisissons de reconnaître et d’accueillir chaque personne dans toute sa singularité, au-delà des seules données cérébrales. Notre démarche privilégie l’écoute globale de l’individu, considérant son histoire, ses ressentis et son parcours comme une empreinte unique à comprendre et à accompagner.
Nous assumons que l’activité cérébrale ne peut être lue qu’à travers le prisme du corps. Qu’un excès de beta peut être la trace d’un front crispé. Qu’un rythme lent peut venir d’une respiration thoracique. Qu’un signal dit « bruité » peut être le langage muet d’un enfant qui lutte.
Et c’est cela, notre spécificité. Non pas une méthode en plus. Mais un regard autre.
 Le cerveau n’est pas un refuge. C’est un miroir.
Le cerveau n’est pas un refuge. C’est un miroir.
Et ce que nous choisissons d’y voir détermine tout le sens de notre accompagnement.
Quand la vision neurocentrée fragilise les familles
À force de tout ramener au cerveau, on finit par oublier ceux qui entourent l’enfant.
Les parents, souvent, ne viennent plus chercher du soutien, mais un diagnostic. Une prescription. Une étiquette pour « expliquer » ce qui échappe à leur intuition. Et dans cette quête de réponse rapide, ils se heurtent à des professionnels eux-mêmes perdus dans des grilles normatives.
Les enseignants, eux, reçoivent des enfants sans corps, mais avec des dossiers. On leur parle de dysfonctionnements attentionnels, jamais de respiration bloquée, de fatigue chronique, d’insécurité tonique.
Or, l’enfant n’est jamais seul. Il est un être de lien. Et cette vision cérébro-centrée isole tout le monde — au lieu de relier.
Changer de paradigme, c’est aussi redonner une place au corps dans les pratiques éducatives et parentales. C’est rappeler que réguler un enfant, ce n’est pas « corriger son cerveau », c’est lui apprendre à habiter pleinement son être.
Ce changement de paradigme n’est pas un rejet des neurosciences, mais une invitation à les réintégrer dans un modèle plus vaste — un modèle où l’humain n’est pas seulement neuronal, mais aussi tonique, rythmique, émotionnel, relationnel, vivant.
Volet 2 – Le chemin
Elle s’appelle Élise.
Elle est pédiatre à Montréal depuis 25 ans. Et cette année, sur les conseils de sa cousine française formée à la neurothérapie intégrative, elle s’est inscrite à notre formation. Un jour, dans un échange simple et sans enjeu, elle m’a dit :
« Je ne veux plus continuer à faire mon métier. Ce n’est plus ce pour quoi j’ai choisi de devenir pédiatre. J’ai le sentiment de vivre sous une pression constante. Les familles viennent me réclamer des ordonnances. Mais mon métier, ce n’est pas de médicamenter les enfants, c’est de les accompagner. »
Ce qu’elle décrivait, ce n’était pas une exception. C’est devenu un quotidien.
Au Québec comme ailleurs, de plus en plus de familles reçoivent un diagnostic de TDAH en télémédecine, sans même qu’un professionnel n’ait pris le temps d’observer l’enfant, d’écouter le contexte familial, de sentir le tonus de fond ou le rythme de la respiration.
Ces consultations à distance, souvent brèves, débouchent sur une prescription immédiate de psychostimulants, parfois dès l’âge de 5 ans. Et les parents, déboussolés, culpabilisés, finissent par croire qu’ils n’ont pas le choix.
Cette crise n’est pas seulement un conflit entre disciplines ou entre modèles. C’est une rupture du soin. C’est la perte, jour après jour, de la relation vivante entre l’enfant, ses parents, et le professionnel censé les accompagner.
Ce jour-là, en entendant Élise, j’ai compris que ce que nous vivions, ce n’était pas seulement une transition thérapeutique.
C’était une insurrection intérieure. Celle de praticiens lucides, conscients, qui ne veulent plus être les opérateurs passifs d’un système automatisé. Qui refusent de réduire l’acte de soin à un acte de prescription.
Et c’est à eux — à nous — que s’adresse la neurothérapie intégrative : une autre posture, une autre écoute, une autre écologie du soin.
Cette tension entre technicisation du soin et oubli de l’humain, le philosophe et neuropsychologue Jacques Corraze, disparu aujourd’hui, l’avait formulée avec force dans Le Déclin de la médecine humaniste.
Il y dénonçait ce paradoxe français : une médecine d’excellence biologique, mais orpheline des sciences humaines. Une médecine qui sait nommer les maladies par leur typologie — « c’est un astrocytome grade 3 », « c’est un TDAH » —, mais qui peine à rencontrer le sujet qui souffre, qui doute, qui cherche un sens.
Corraze défendait, contre cette dérive, le modèle biopsychosocial : une médecine qui exige, au-delà de la compétence technique, une éthique de la présence, une intelligence du lien, un regard sur l’autre comme être humain vivant.
Il fut aussi l’un des promoteurs de l’école de psychomotricité de Toulouse, et cosignataire avec Patricia Abeilhou, aujourd’hui formatrice à l’Institut Neurosens, d’un article pionnier publié dans Farnace intitulé : « Le biofeedback, une voie d’avenir pour les psychomotriciens ? » (Corraze & Abeilhou, 2002). Dans ce texte visionnaire, ils anticipaient déjà la nécessité d’outils permettant d’objectiver sans réduire, de mesurer sans déshumaniser, de soigner sans déposséder le sujet de sa propre capacité d’ajustement.
C’est cette voie que nous prolongeons aujourd’hui.
Une voie qui ne renonce ni à la rigueur scientifique, ni à la complexité vivante.
Une voie qui refuse que le soin se réduise à un algorithme ou à un dosage.
Une voie où le thérapeute est d’abord un être en lien, et non un technicien du symptôme.
Comment devenir un neurothérapeute incarné — Itinéraire d’un passage
De la fascination à la présence : le parcours du praticien face à ses propres besoins de maîtrise
Tout commence souvent par une fascination : celle des ondes cérébrales, des couleurs du brain map, des courbes qui montent et descendent comme un électrocardiogramme de l’âme. Pour celui qui découvre le neurofeedback, c’est un monde nouveau, mesurable, normatif, rassurant. On y entre avec le désir de comprendre, de maîtriser, de réparer.
Mais cette quête de maîtrise peut devenir un piège. Car derrière le besoin de tout mesurer se cache souvent la peur de ne pas savoir ressentir. Derrière le protocole parfait, l’angoisse de l’incertitude relationnelle. Et derrière le fantasme d’objectivité, une difficulté à tolérer la complexité du vivant.
C’est alors qu’un premier retournement s’opère : le thérapeute ne cherche plus à dominer la technique, mais à s’habiter lui-même.
Rouvrir l’écoute du corps : tonus, respiration, posture, rythmes lents
Il apprend à ressentir — non pas seulement chez l’autre, mais en lui. À observer le souffle qui s’accélère dans une séance tendue. À sentir la tension de sa mâchoire quand un enfant résiste. À percevoir le micro-ajustement postural qui trahit une attention flottante.

Il découvre que le corps est déjà une lecture.
Non pas un simple récepteur passif, mais une antenne vivante, traversée de rythmes anciens, souvent oubliés par les approches cognitivo-centrées.
Ce que l’EEG capte — ou croit capter — est en réalité le résultat d’une interaction permanente entre le vivant et l’environnement, entre le dedans et le dehors, entre les états toniques et les états mentaux.
On y retrouve le tonus de fond, cette tension de base issue du rapport à la gravité ; la respiration, tour à tour ventrale ou thoracique ; le souffle ventilatoire, lorsque la ventilation nasale circule librement et vient rythmer les oscillations cérébrales à travers les boucles olfacto-limbiques ; le rythme cardiaque, reflet de l’équilibre neurovégétatif ; les ajustements posturaux, imperceptibles mais essentiels.
Ces rythmes ne sont pas des artefacts.
Ce sont des empreintes physiologiques et psychophysiologiques.
Accompagner sans contrôler
La place de la relation, du doute, de la transformation intérieure du thérapeute
Le praticien qui chemine découvre que l’essentiel ne réside pas dans la maîtrise parfaite des protocoles, mais dans la qualité de la relation qu’il instaure.
Accompagner, c’est parfois désapprendre à vouloir corriger. C’est accepter l’imperfection du vivant, reconnaître l’incertitude comme source de créativité, laisser une place à l’imprévu.
C’est aussi accueillir ses propres mouvements intérieurs : le doute, la peur de mal faire, l’élan de contrôle, la tentation de performer.
Peu à peu, le neurothérapeute ne devient pas seulement technicien du signal, mais témoin d’un chemin de transformation. Il affine son écoute, régule sa propre présence, développe une forme de posture incarnée.
Il devient lui-même un instrument vivant de régulation.
L’après : construire ensemble une nouvelle écologie du soin
Pédagogie, communauté, conscience
Ce chemin ne se parcourt pas seul. Il appelle à une autre manière de penser la clinique : plus systémique, plus incarnée, plus relationnelle.
C’est le cœur même de la neurothérapie intégrative : croiser les regards, relier les corps, restaurer les liens.
Former, c’est alors transmettre une attitude, pas seulement des savoirs.
C’est ouvrir un espace de communauté apprenante, où chaque thérapeute peut devenir plus conscient de ses gestes, de ses intentions, de ses présupposés.
La pédagogie devient un art de cultiver la conscience.
Et l’accompagnement, un art d’honorer la complexité du vivant.
« C’est à un être humain que le médecin reste confronté : un patient qui souffre, a peur, se pose des questions, et dont l’état psychologique va influer sur le devenir de sa maladie. »
— Jacques Corraze, Le déclin de la médecine humaniste, 2016
Passer du contrôle à la conscience
Ce texte est une invitation. Une mue.
Pas une condamnation du passé, ni une disqualification de vos premiers pas.
Nous savons que beaucoup d’entre vous ont découvert le neurofeedback comme on découvre une promesse : celle d’aider, de comprendre, de réparer. Et cette promesse est toujours valable — à condition d’en déplacer l’ancrage.
Ce n’est pas la machine qui transforme.
C’est la relation.
Ce n’est pas l’algorithme qui guide.
C’est la présence.
Le neurofeedback, dans une approche intégrative et incarnée, peut devenir un art d’écouter le vivant, un espace de co-régulation, un pont entre le corps et la conscience.
Mais pour cela, il faut oser :
-
- se délester des certitudes,
- descendre dans le corps,
- affiner la sensation,
- et redevenir humble face à la complexité du vivant.
La neurothérapie intégrative est une voie.
Une voie exigeante, mais profondément humaine.
Une voie où l’on n’enseigne pas seulement des techniques,
mais où l’on accompagne des transformations.
À celles et ceux qui sentent que le chemin les appelle : bienvenue.
Vous n’êtes pas seuls. Une communauté vous attend.
cle ici...